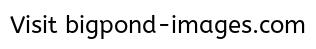De tous les univers explorés par les séries télévisées, celui qui a le plus souffert du traitement apporté par les scénaristes est sans contestation possible le monde de l'adolescence. S'il est tout à fait possible de citer en moins de dix secondes au moins 5 séries policières ou médicales de très bon niveau, la tâche devient très difficile quand il s'agit de nommer des séries pour ou au sujet des adolescent. En fait, avant le début des années 90, parler du sujet ne se conçoit que sous deux angles, soit un sitcom regroupant tout les stéréotypes imaginables du teen-ager, du petit génie au boy-scout en passant par la féministe et le couple idéal Cheerleader/Capitaine de l'équipe de football, soit une comédie dramatique diluée dans l'eau de rose jusqu'à l'écoeurement.
Aussi, lorsque ABC programme pour la rentrée 1994 une série nommée My So-called Life, personne n'y prête réellement attention. Les producteurs sont connus pour avoir déjà travaillé ensemble sur la série the Wonder years, évocation de l'enfance durant les années 60, mais le sujet traité n'incite pas réellement à l'enthousiasme, toutes les tentatives précédentes n'ayant jamais abouties à de vrais réussites. Pourtant cette fin du mois d'août va marquer un tournant dans le traitement des séries pour adolescents.
La base de l'histoire est la même que pour toutes les séries du genre, Angela Chase, âgée de 15 ans, est lycéenne dans la ville de Liberty, située dans la banlieue de Pittsburgh. Ses journées se passent entre les cours, les amis et la recherche du grand amour, qui prend ici les traits d'un garçon plus vieux de deux ans, Jordan Catalano. Celui-ci ne la remarque absolument pas, comme elle ne voit pas que Brian Krakow, son voisin, est totalement fou d'elle. Quand on rajoute au tableau des parents dépassés par la métamorphose de leur fille on obtient plus ou moins une série typique sur le sujet, avec une marge de manœuvre que l'on pourrait qualifier de réduite.
Néanmoins l'angle pris par le trio Herskovitz Zwick Holzmann apporte une vraie nouveauté en ceci qu'au lieu de choisir les personnages dans les franges les plus populaires du lycée, la loupe est posée sur ceux qui sont habituellement les oubliés des scénarios, les gens ordinaires. Ici pas de sportifs et de cheerleaders, pas de beau gosse au sourire ultra brite, mais des gens normaux définis par leurs défauts et leurs craintes.
Angela se trouve beaucoup trop banale pour être séduisante, et la peur que lui inspire le regard des autres est le principal obstacle entre elle et Jordan. Ses deux meilleures amies sont Rayanne Graff, élément perturbateur du lycée qui enfouit son besoin de figure maternelle sous un comportement provocant et des litres d'alcool, et Sharon Cherski, qui développe un complexe vis à vis de son physique trop avantageux et une peur panique des relations humaines. Du coté des garçons, Jordan est miné par ses difficultés scolaires et cache le fait qu'il est incapable de lire, Brian souffre d'une timidité dévorante qui l'oblige à cacher ses sentiments derrière une attitude quasi dédaigneuse et utilise son appareil photo pour ne pas avoir à se dévoiler, Rickie Vazquez, qui affiche trop ouvertement son homosexualité pour réussir à l'assumer et cache des blessures intimes derrière son maquillage et ses tenues bariolées.
Ceux qui pensaient trouver un support du coté des parents seront là aussi déçus, les Chase sont trop en proie à leurs propres problèmes pour pouvoir gérer ceux de leurs filles (Patty reproduit avec ses parents le comportement de sa fille vis à vis d'elle et Graham souffre du fait qu'il travaille sous les ordres de sa femme), la mère de Rayanne se comporte plus comme une meilleure amie que comme une vraie mère, celle de Sharon n'est jamais présentée sous un rapport d'autorité familiale, les autres parents étant au mieux absents.
Tous ces personnages sont portés par une interprétation de très haut niveau, emmenée par le couple vedette Claire Danes et Jared Leto, servis par des seconds rôles excellents (dans l'ordre de citation des personnages Devon Gummersall, AJ Langer, Devon Odessa, Wilson Cruz, ...) et une écriture juste et loin des idées reçues, bien que n'évitant pas certains écueils (un épisode évoquant trop Dead Poets Society par exemple). Il est à noter que Claire Danes, découverte par les producteurs dans un épisode de Law & Order, est plus jeune que le personnage qu'elle interprète dans la série (13 ans au début du tournage contre 15 pour Angela Chase), ce qui est un cas quasi unique, les lois sur le travail des mineurs incitant les chaînes à prendre de jeunes adultes pour jouer des adolescents.
Dès le premier épisode, les critiques saluent unanimement le travail réalisé par les producteurs et font de la série une de leur favorites, de même que les téléspectateurs qui la regardent sont parmi les plus fidèles. Malheureusement, les audiences sont inférieures aux attentes d'ABC qui écourte la première saison à 19 épisodes. Après la diffusion du final, alors que les attentes des fans sont pressantes, la chaîne joue la montre et retarde au maximum sa décision quand au renouvellement du show. Claire Danes, lassée d'attendre une réponse, décide de donner son accord à Baz Luhrmann pour jouer le rôle de Juliette dans sa version de la pièce de Shakespeare, laissant ainsi le champ libre pour l'annulation de la série privée de son personnage principal.
Le traumatisme est d'autant plus grand chez les inconditionnels de la série que de multiples pistes avaient été lancées pour une deuxième saison et restent ainsi en suspens. Parmi les fans éplorés, un jeune scénariste nommé Joss Wheddon se fit la promesse que, si d'aventure il venait à travailler pour la télévision, jamais il ne finirait une saison sur une situation ouverte sans avoir la certitude de revenir un an de plus pour la conclure. Et il a toujours tenu parole depuis.
Aussi, lorsque ABC programme pour la rentrée 1994 une série nommée My So-called Life, personne n'y prête réellement attention. Les producteurs sont connus pour avoir déjà travaillé ensemble sur la série the Wonder years, évocation de l'enfance durant les années 60, mais le sujet traité n'incite pas réellement à l'enthousiasme, toutes les tentatives précédentes n'ayant jamais abouties à de vrais réussites. Pourtant cette fin du mois d'août va marquer un tournant dans le traitement des séries pour adolescents.
La base de l'histoire est la même que pour toutes les séries du genre, Angela Chase, âgée de 15 ans, est lycéenne dans la ville de Liberty, située dans la banlieue de Pittsburgh. Ses journées se passent entre les cours, les amis et la recherche du grand amour, qui prend ici les traits d'un garçon plus vieux de deux ans, Jordan Catalano. Celui-ci ne la remarque absolument pas, comme elle ne voit pas que Brian Krakow, son voisin, est totalement fou d'elle. Quand on rajoute au tableau des parents dépassés par la métamorphose de leur fille on obtient plus ou moins une série typique sur le sujet, avec une marge de manœuvre que l'on pourrait qualifier de réduite.
Néanmoins l'angle pris par le trio Herskovitz Zwick Holzmann apporte une vraie nouveauté en ceci qu'au lieu de choisir les personnages dans les franges les plus populaires du lycée, la loupe est posée sur ceux qui sont habituellement les oubliés des scénarios, les gens ordinaires. Ici pas de sportifs et de cheerleaders, pas de beau gosse au sourire ultra brite, mais des gens normaux définis par leurs défauts et leurs craintes.
Angela se trouve beaucoup trop banale pour être séduisante, et la peur que lui inspire le regard des autres est le principal obstacle entre elle et Jordan. Ses deux meilleures amies sont Rayanne Graff, élément perturbateur du lycée qui enfouit son besoin de figure maternelle sous un comportement provocant et des litres d'alcool, et Sharon Cherski, qui développe un complexe vis à vis de son physique trop avantageux et une peur panique des relations humaines. Du coté des garçons, Jordan est miné par ses difficultés scolaires et cache le fait qu'il est incapable de lire, Brian souffre d'une timidité dévorante qui l'oblige à cacher ses sentiments derrière une attitude quasi dédaigneuse et utilise son appareil photo pour ne pas avoir à se dévoiler, Rickie Vazquez, qui affiche trop ouvertement son homosexualité pour réussir à l'assumer et cache des blessures intimes derrière son maquillage et ses tenues bariolées.
Ceux qui pensaient trouver un support du coté des parents seront là aussi déçus, les Chase sont trop en proie à leurs propres problèmes pour pouvoir gérer ceux de leurs filles (Patty reproduit avec ses parents le comportement de sa fille vis à vis d'elle et Graham souffre du fait qu'il travaille sous les ordres de sa femme), la mère de Rayanne se comporte plus comme une meilleure amie que comme une vraie mère, celle de Sharon n'est jamais présentée sous un rapport d'autorité familiale, les autres parents étant au mieux absents.
Tous ces personnages sont portés par une interprétation de très haut niveau, emmenée par le couple vedette Claire Danes et Jared Leto, servis par des seconds rôles excellents (dans l'ordre de citation des personnages Devon Gummersall, AJ Langer, Devon Odessa, Wilson Cruz, ...) et une écriture juste et loin des idées reçues, bien que n'évitant pas certains écueils (un épisode évoquant trop Dead Poets Society par exemple). Il est à noter que Claire Danes, découverte par les producteurs dans un épisode de Law & Order, est plus jeune que le personnage qu'elle interprète dans la série (13 ans au début du tournage contre 15 pour Angela Chase), ce qui est un cas quasi unique, les lois sur le travail des mineurs incitant les chaînes à prendre de jeunes adultes pour jouer des adolescents.
Dès le premier épisode, les critiques saluent unanimement le travail réalisé par les producteurs et font de la série une de leur favorites, de même que les téléspectateurs qui la regardent sont parmi les plus fidèles. Malheureusement, les audiences sont inférieures aux attentes d'ABC qui écourte la première saison à 19 épisodes. Après la diffusion du final, alors que les attentes des fans sont pressantes, la chaîne joue la montre et retarde au maximum sa décision quand au renouvellement du show. Claire Danes, lassée d'attendre une réponse, décide de donner son accord à Baz Luhrmann pour jouer le rôle de Juliette dans sa version de la pièce de Shakespeare, laissant ainsi le champ libre pour l'annulation de la série privée de son personnage principal.
Le traumatisme est d'autant plus grand chez les inconditionnels de la série que de multiples pistes avaient été lancées pour une deuxième saison et restent ainsi en suspens. Parmi les fans éplorés, un jeune scénariste nommé Joss Wheddon se fit la promesse que, si d'aventure il venait à travailler pour la télévision, jamais il ne finirait une saison sur une situation ouverte sans avoir la certitude de revenir un an de plus pour la conclure. Et il a toujours tenu parole depuis.