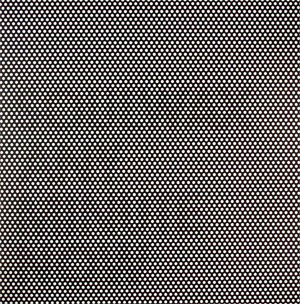J'ai déjà parlé du leader Buzz Osborne des Melvins, ici, et si vous aimez les manèges à sensations et la saturation, je ne saurai que vous conseiller de vous ruer sur son groupe originel et culte (The Melvins, donc). Groupe très productif et toujours très confidentiel malgré ses vingt ans et des poussières de carrière, car n'ayant jamais émis la moindre concession. Entre expérimentations sonores à la limite du supportable et métal joyeux, entre country pour rire et riffs décalés, le tout sous une chape de plomb-marque de fabrique, on a toujours fait ce qu'on a voulu, chez les Melvins. Même si finalement, leur son est reconnaissable immédiatement et qu'à la suite de sorties incessantes d'albums, leurs morceaux semblent être toujours les mêmes, les idées tombent rarement à plat. La preuve dans ce Nude With Boots de 2008, ni le meilleur ni le pire, juste un bon disque qui propose l'avantage d'être assez simple d'accès. L'âge, sans doute. En tout cas, un bon début pour s'initier.
Folle de rage de les avoir loupés aux Eurockéennes de Belfort suite à une programmation défaillante, la groupie hystérique en moi ne rata pas l'occasion de courir les voir dans une petite salle où à peine deux cents personnes s'étaient déplacées pour l'occasion. En première partie, Porn, un groupe français que je ne connais ni d'Eve ni de Rocco, et sur lequel je vous invite à faire des recherches vous-mêmes, car je n'en ai franchement pas le courage, là. Du coup, je n'ai vraiment pas compris qui étaient les membres de cette première partie muette mais sonique. Un type entre en scène, enfile une guitare, se place devant une console et commence à triturer moults boutons et potentiomètres, ce qui nous gratifie de serpents dignes de Jesu, vire psychédélique, et dure un bon quart d'heure. Sur quoi arrivent un bassiste et deux batteurs, dont Dale Crover, la machine métronomique pleine de technique des Melvins. Ah ? Sympa, hé. Surtout que ça tombe bien : les deux batteries sont au milieu de la scène et partagent des cymbales. Crover est droitier, sa batterie est à gauche de la scène, tandis que son comparse est gaucher, son kit à lui est donc à droite. Et ils jouent de concert (huhu). Ou se partagent les tâches. Ca tabasse sec après une intro pleine de coups feutrés sur les cymbales, partis pour deux fois vingt minutes de métal basique mais planant : la répétition et les serpents tournoient dans l'air. Ca commence bien, même si personne ne cause. Pause.
Puis arrive King Buzzo (à un mètre de moi, je souris bêtement béatement), encore plus gros, sa tignasse grise toujours folle, drapé d'une robe de bure noire ornée d'un étoile entre les pieds, sa guitare entièrement argentée tranche dessus. Dale Crover reprend sa place. Et sans pédales d'effet ni archet ni jeux de lumière clinquants, les Melvins canal historique singent les White Stripes ou les Black Keys en enchaînant une dizaine de titres très courts, se partageant même le chant. Rigolo. Mais bon, manque le son, quand même. Manque la lourdeur. Mes craintes disparaissent lorsque le second batteur revient (mais est-ce le même ?), affublé d'une robe hindoue, accompagné d'un autre bassiste perruqué barbu à chemise hippie. Et c'est reparti pour une petite vingtaine de minutes de tabassements. Et nom de dieu ce que ça joue, ça aligne les breaks pas évidents et les ambiances poisseuses, ça improvise aux batteries pour enchaîner les titres, les quatre zouaves alignés chantent tous, transpirent tous énormément, mais jamais ne semblent s'ennuyer. Puis Buzzo lance "We'll be right back". Pause deux.
Retour des quatre mêmes, cinquante nouvelles minutes de titres assemblés comme des Lego, aucun temps mort, juste un arrêt pour que nous chantions tous un joyeux anniversaire à Garreth (je crois), le roadie, attrapé et jeté par terre par le hippie alors qu'il venait de se faire piéger par le bassiste (c'est le même pour ceux qui suivent pas) qui avait soi-disant un problème d'ampli. Car oui, on sait aussi rire chez les Melvins. Ca se termine sur une impro à deux batteries, pas d'embrassades, pas d'adieux déchirants, pas de ce n'est qu'un au revoir, juste un peu plus de deux heures trente de sons. Pour vingt-deux euros (je balance, ouais, parfaitement). J'ai peut-être bien fait de les louper aux Eurocks finalement. Et pour finir, une phrase à cliquer pour avoir une idée de ce que je viens de relater.
Folle de rage de les avoir loupés aux Eurockéennes de Belfort suite à une programmation défaillante, la groupie hystérique en moi ne rata pas l'occasion de courir les voir dans une petite salle où à peine deux cents personnes s'étaient déplacées pour l'occasion. En première partie, Porn, un groupe français que je ne connais ni d'Eve ni de Rocco, et sur lequel je vous invite à faire des recherches vous-mêmes, car je n'en ai franchement pas le courage, là. Du coup, je n'ai vraiment pas compris qui étaient les membres de cette première partie muette mais sonique. Un type entre en scène, enfile une guitare, se place devant une console et commence à triturer moults boutons et potentiomètres, ce qui nous gratifie de serpents dignes de Jesu, vire psychédélique, et dure un bon quart d'heure. Sur quoi arrivent un bassiste et deux batteurs, dont Dale Crover, la machine métronomique pleine de technique des Melvins. Ah ? Sympa, hé. Surtout que ça tombe bien : les deux batteries sont au milieu de la scène et partagent des cymbales. Crover est droitier, sa batterie est à gauche de la scène, tandis que son comparse est gaucher, son kit à lui est donc à droite. Et ils jouent de concert (huhu). Ou se partagent les tâches. Ca tabasse sec après une intro pleine de coups feutrés sur les cymbales, partis pour deux fois vingt minutes de métal basique mais planant : la répétition et les serpents tournoient dans l'air. Ca commence bien, même si personne ne cause. Pause.
Puis arrive King Buzzo (à un mètre de moi, je souris bêtement béatement), encore plus gros, sa tignasse grise toujours folle, drapé d'une robe de bure noire ornée d'un étoile entre les pieds, sa guitare entièrement argentée tranche dessus. Dale Crover reprend sa place. Et sans pédales d'effet ni archet ni jeux de lumière clinquants, les Melvins canal historique singent les White Stripes ou les Black Keys en enchaînant une dizaine de titres très courts, se partageant même le chant. Rigolo. Mais bon, manque le son, quand même. Manque la lourdeur. Mes craintes disparaissent lorsque le second batteur revient (mais est-ce le même ?), affublé d'une robe hindoue, accompagné d'un autre bassiste perruqué barbu à chemise hippie. Et c'est reparti pour une petite vingtaine de minutes de tabassements. Et nom de dieu ce que ça joue, ça aligne les breaks pas évidents et les ambiances poisseuses, ça improvise aux batteries pour enchaîner les titres, les quatre zouaves alignés chantent tous, transpirent tous énormément, mais jamais ne semblent s'ennuyer. Puis Buzzo lance "We'll be right back". Pause deux.
Retour des quatre mêmes, cinquante nouvelles minutes de titres assemblés comme des Lego, aucun temps mort, juste un arrêt pour que nous chantions tous un joyeux anniversaire à Garreth (je crois), le roadie, attrapé et jeté par terre par le hippie alors qu'il venait de se faire piéger par le bassiste (c'est le même pour ceux qui suivent pas) qui avait soi-disant un problème d'ampli. Car oui, on sait aussi rire chez les Melvins. Ca se termine sur une impro à deux batteries, pas d'embrassades, pas d'adieux déchirants, pas de ce n'est qu'un au revoir, juste un peu plus de deux heures trente de sons. Pour vingt-deux euros (je balance, ouais, parfaitement). J'ai peut-être bien fait de les louper aux Eurocks finalement. Et pour finir, une phrase à cliquer pour avoir une idée de ce que je viens de relater.